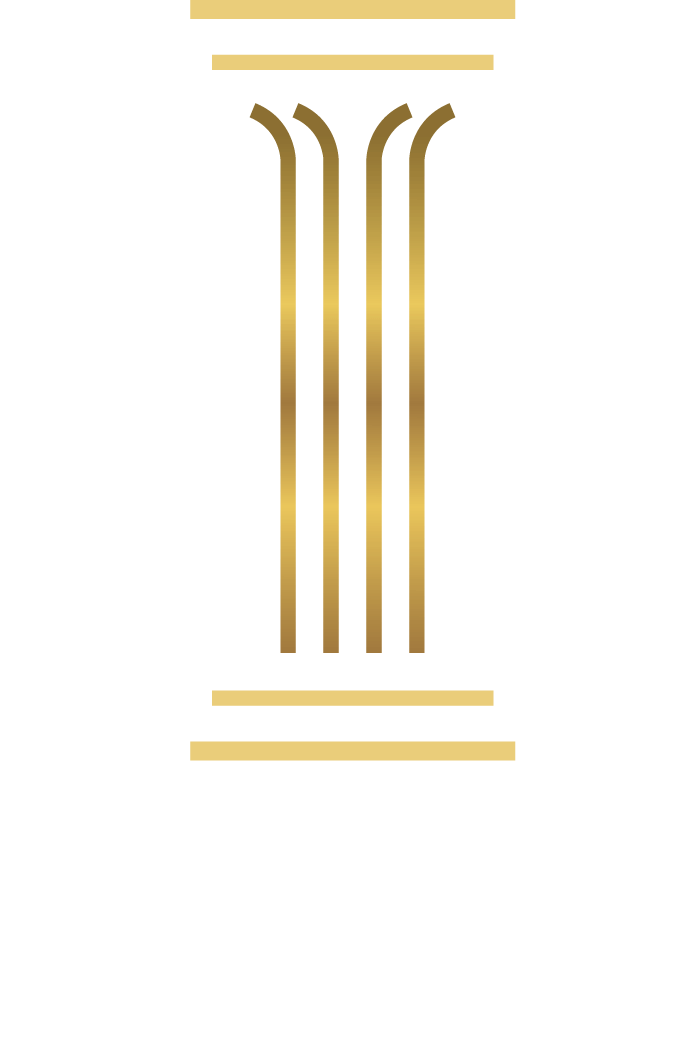Certains voudraient créer une Opep du cacao regroupant les pays africains qui produisent 78 % du cacao mondial. Mais c’est plutôt de la compagnie De Beers, leader mondial du secteur du diamant, que les producteurs de fèves, à commencer par le Ghana et la Côte d’Ivoire, devraient s’inspirer.
Pourquoi ? Parce qu’il existe des différences fondamentales entre le cacao et le pétrole. Tout d’abord, la valeur du cacao ne vient pas tant du produit brut mais du chocolat, dont le marché pèse dix fois plus (respectivement 8 et 80 milliards d’euros en 2016). Ensuite, si le pétrole est le carburant du monde, le chocolat reste – comme le diamant – un produit de luxe, consommé principalement en Europe et en Amérique du Nord.
Or, dans un contexte où les cours ne sont pas près de retrouver les prix records d’août 2016 (2 500 livres, soit 3 000 euros, par tonne), le conglomérat sud-africain est un exemple à suivre pour son habilité à fournir le marché par à-coups, juste assez pour toujours s’assurer un prix de vente rémunérateur. S’en inspirer conduirait à créer une entité commerciale, certes détenue par les pays producteurs, mais composée de technocrates rompus au commerce international ayant pour seul but la vente de produits semi-finis et finis. On éviterait ainsi de donner naissance à une nouvelle organisation intergouvernementale, avec toutes les contingences et pesanteurs politiques que cela suppose.
Pour réussir cette révolution, plusieurs réformes sont nécessaires :
• Maîtriser la production. Ces dernières années, les industriels se sont lancés dans une politique d’augmentation de la productivité. Cette démarche est une bombe à retardement si l’on ne maîtrise pas l’évolution des superficies cultivées. Il faut donc que les États procèdent à un recensement des parcelles, fixent des quotas par pays et constituent des stocks tampons afin de faire face aux fluctuations de la demande. Le contrôle de l’offre est d’autant plus facile que le cacao n’a pas de substitut : une faible variation de l’offre suffirait à faire bouger les prix des fèves.
• Prendre en main la commercialisation intérieure. La meilleure manière de rémunérer le planteur au juste prix est de le faire soi-même. Les États doivent mettre en place des politiques pluriannuelles d’achat qui permettront aux planteurs de se projeter dans le temps, d’avoir des revenus stables, et donc de contracter des prêts, de souscrire des assurances ou des pensions de retraite.
• Améliorer l’accès aux financements. Le passage d’une économie de cueillette à une économie industrielle est devenu une priorité. Cependant, les transformateurs locaux font face à un problème de compétitivité. En Côte d’Ivoire, le taux de leurs crédits pour l’achat des fèves est au mieux à 7 %, quand les groupes internationaux se financent à 1 %. Nos États doivent créer un fonds soutenu par une taxe à l’exportation qui permettrait aux industriels locaux de bénéficier de prêts à des taux bonifiés. Il faudrait en outre que les banques de la zone UEMOA permettent aux négociants de s’assurer contre la volatilité des cours, en diversifiant leur offre de services, notamment en ce qui concerne la couverture du risque.
• Organiser la cotation des sous-produits. Dans cette filière, à la différence de celle du pétrole, il n’existe pas de marché de référence pour les sous-produits que sont la masse, le beurre et la poudre de cacao. Les pays producteurs peuvent devenir maîtres de leur destin en créant, à l’instar de la Malaisie pour l’huile de palme brute, des marchés de référence.
• Multiplier les débouchés. La stabilité du prix du cacao repose sur la capacité de nos États à créer un marché local pour le cacao et ses produits dérivés : transformation des fèves en biocarburants, utilisation des feuilles comme coupe-faim, de la cabosse pour faire des engrais… Les pistes de recherche sont nombreuses pour peu qu’un fonds permette de les explorer et qu’une politique de commande publique assure au moins pendant un temps la viabilité de ces nouvelles filières.